Tracer des chemins de redirection du numérique
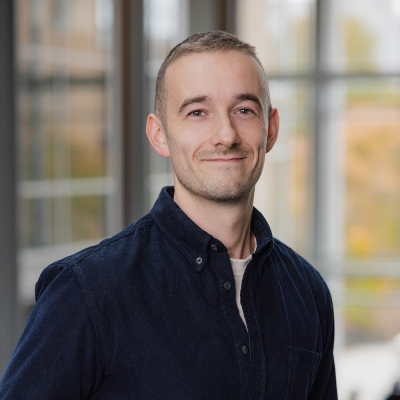
Martin Deron
Épisode 98 publié le 22/10/2025
Responsable du défi numérique à l'université de Montreal, Martin Deron est aussi Doctorant à l'université de Concordia et mène ses recherches sur la redirection du numérique en connaissance des limites planétaires.
En écoutant cet épisode, vous téléchargerez 16 Mo de données.
En savoir plus :
Transcription
Extrait
Je m'intéresse à la place envisagée des technologies numériques dans les scénarios de décroissance, de post-croissance, de planification démocratique de l'économie, ou d'autres scénarios de transition socio-écologique réussie. On se dit, d'ici 10, 15, 20, 25 ans, à quoi ça ressemble, selon nous, une transition socio-écologique réussie ? Quel type de valeur on envisage derrière ? Quel type de modèle de société on envisage derrière ?
Introduction
Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Martin Deron, qui nous vient du Canada. Et on s'est posé dans un square à Paris, au milieu du bruit. Vous allez avoir tous les bruits d'ambiance, peut-être les pigeons. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Et voilà, ça m'intéressait un peu d'échanger avec Martin parce qu'il travaille sur les questions de transition écologique du numérique.
Martin, peux-tu nous présenter un peu plus en détail ce que tu fais ?
Oui, bien sûr. Et puis, merci beaucoup pour cet échange. C'est un format un peu inhabituel, mais fort agréable.
Donc, je m'appelle Martin Deron. Je suis basé à Montréal. Je travaille à l'Université de Montréal sur des questions qui sont à la convergence des transitions socio-écologiques et des transitions redirection du numérique.
Et je suis également à l'Université de Concordia, qui se trouve à Montréal aussi, où je fais un programme doctoral sur ces questions.
Mais on aura certainement l'occasion de plonger un petit peu plus précisément.
Il y a quelques années, tu as travaillé sur un rapport "chemins de transition" sur le sujet numérique. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, en bref résumé, de quoi il s'agissait ?
En fait, les chemins de transition, c'est le nom du projet plus global. C'est un projet de l'Université de Montréal qui a commencé en janvier 2020, qui s'intéressait, si tu veux, à la transition socio-écologique au Québec à travers différents grands défis, différentes grandes thématiques.
On est une partie de l'équipe qui s'intéresse à la transition du système alimentaire. Une partie de l'équipe qui s'intéresse à la transition du territoire, toutes les questions de logement, de transport. Et moi, je me suis intéressé à la transition du système numérique.
C'était pas mal dans l'air du temps, début 2020, avec les travaux du Shift Project, les travaux de la Fing, les travaux autour de Reset, tout ça. On se posait la question, comme d'autres, sur quelle perspective on pouvait envisager pour la convergence entre la numérisation de nos sociétés et la transition socio-écologique. On a travaillé sur ces questions pendant plusieurs années. En fait, le projet existe encore, même.
On a mobilisé des approches prospectives pour, dans un premier temps, essayer d'envisager une pluralité d'avenirs possibles à cette intersection entre numérique et environnement. Et donc, on se posait la question, à quoi pourrait ressembler la société québécoise en 2040 à travers une diversité de scénarios prospectifs, donc à travers une diversité de scénarios possibles, le futur possible.
Ce qui distingue un peu cette initiative d'autres, on a développé des méthodes participatives pour aller chercher d'autres types de savoirs. Bien sûr, des savoirs académiques, mais aussi des savoirs citoyens, des savoirs professionnels. On a organisé beaucoup d'ateliers, beaucoup d'initiatives de mobilisation de connaissances pour pouvoir travailler, justement, sur une forme de ligne de crête, de convergence du numérique et de la transition socio-écologique à l'horizon 2040.
C'est une initiative qui a duré plusieurs années, où on a une phase de mobilisation de ces connaissances-là qui a duré à peu près deux ans. Et depuis 2022, on fait surtout du transfert sur ces questions. On a rendu disponibles les trajectoires sur lesquelles on a travaillé, toutes les réflexions qui ont découlé, les angles morts également qu'on avait identifiés.
Bien sûr, on a travaillé sur des trajectoires, mais ce n'est pas des trajectoires qui prédisent l'avenir. Ce n'est pas des trajectoires, ce n'est pas une feuille de route. Bien sûr, on a travaillé sur un chemin de transition pour que le numérique s'arrime davantage aux objectifs de transition socio-écologique. Mais ça vient avec des changements nécessaires identifiés, mais ça vient également avec des préoccupations, des questions, des nœuds du futur. On a rendu tout ça disponible.
Et puis, depuis 2022, on fait beaucoup de transferts autour de ces questions. On essaie de rendre ces connaissances-là disponibles, qu'elles puissent être mises à l'épreuve, qu'on puisse les faire évoluer avec les autres acteurs et actrices de la société québécoise sur ces questions. Voilà, ça fait à peu près maintenant cinq, six ans qu'on travaille à cette intersection de différentes façons.
Et tu parlais donc de changements nécessaires. Est-ce que tu as des exemples de changements pour aller vers une société un peu plus souhaitable ?
Dans la trajectoire du défi numérique de chemin de transition, à travers l'exploration de ces futurs possibles, on a eu toute une première étape. On a essayé de se mettre d'accord sur ça ressemblerait à quoi un futur désirable, ou vers quoi on aimerait avancer collectivement.
On a fait une série d'ateliers pour explorer ces futurs possibles, puis discuter entre nous d'aspects un peu plus normatifs, de c'est quoi les éléments des futurs possibles qu'on trouve désirables, quels sont les éléments des futurs possibles qu'on trouve redoutables, les questions de demain, les tensions, les leviers. Ce qui fait qu'après une douzaine d'ateliers, on est arrivé à une vision d'un futur qui soit potentiellement à la fois possible et désirable, qu'on a arrimé autour de trois grands piliers.
On a tout un pilier autour de la réduction des impacts environnementaux ou des effets environnementaux liés aux technologies numériques, principalement les effets directs, mais on essaye autant que peut d'inclure là-dedans des effets de secondaire, de troisième ordre, indirect, rebond. C'est un pilier qu'on pourrait appeler la sobriété numérique.
Et on a deux autres piliers également qui, je pense, sont intéressants aussi, peut-être de le mentionner, ils ne font pas toujours partie des autres initiatives qui ont entrepris des travaux similaires.
On a tout un pilier autour de ce qu'on a appelé la priorisation collective du numérique ou des usages du numérique. Cette réflexion que le numérique est à la fois limité et aujourd'hui très inéquitablement réparti.
Si on est en changement de paradigme où on aborde les questions numériques davantage sous une question de gestion, d'allocation ou en tout cas de distribution et de remise en question de la place du numérique dans la société, qu'est-ce que ça veut dire sur des services numériques qui seraient peut-être considérés comme essentiels et comment est-ce qu'on garantit un accès à toutes et tous à ces services ? Et à l'inverse, si on doit collectivement renoncer à certains usages ou certaines formes de numérique, comment est-ce qu'on se dote de mécanismes pour pouvoir prendre ces décisions ? Est-ce qu'on les prend à des échelles sectorielles ? Est-ce qu'on les prend à l'échelle des usages ? Est-ce qu'on les prend à l'échelle des modèles d'affaires ?
On a voulu faire ressortir par ce deuxième pilier le besoin de questionner collectivement la place du numérique dans nos sociétés, de le repolitiser si on veut en termes de débats collectifs.
Ensuite, on a un troisième pilier qui s'intéresse lui à l'écosystème de l'innovation technologique et des modèles d'affaires qu'il y a derrière. Donc, de se dire si on a besoin peut-être, si on identifie des besoins en lien avec la transition socio-écologique qui appelle peut-être plus de formes du numérique ou d'autres formes de numérique, comment est-ce qu'on s'assure que l'écosystème qui les fait naître est lui-même compatible avec les limites planétaires et sort lui-même d'une logique d'accumulation perpétuelle qui ne repose pas justement sur un renouvellement fréquent des appareils ou de l'utilisation de plus en plus importante de services numériques. Comment est-ce qu'on fait une innovation technologique orientée vers la transition socio-écologique en pensant à la question des modèles d'affaires, si on veut.
À partir de cette vision, on a eu un travail qu'on appelle un travail de "backcasting" ou en fait, on pourrait dire de "rétro", de Rétro-ingénierie, peut-être, où on part de cette vision du futur souhaité, en tout cas pour les personnes qui ont pris part à l'exercice, et on se dit, c'est quoi les étapes essentielles pour y arriver dans une génération à peu près, donc, à une période d'à peu près 20 ans. Et donc, en reculant comme ça, on a identifié 33 grandes étapes, qui ne sont bien sûr pas des étapes exhaustives, mais en tout cas, 33 basculements importants pour passer de la situation actuelle à cette société visée en 2040.
Tout ça, c'est bien sûr disponible sur notre site internet, cheminsdetransition.org. Les personnes que ça intéresse pourront retrouver les détails de cette trajectoire et les jalons, en fait, ces étapes intermédiaires qui le composent.
Mais de manière générale, vous allez retrouver des jalons qui s'intéressent à, bien sûr, de façon assez classique, l'allongement, la durée de vie du matériel existant, pour pouvoir s'intéresser à la réduction des impacts directs du numérique. Mais également d'autres jalons qui s'intéressent plus à, comment est-ce qu'on se dote de lieux de délibération pour discuter de ces questions-là.
On a des jalons qui s'intéressent à la mesure mais pas uniquement dans une optique d'efficience ou d'efficacité, mais plutôt de conditionnalité.
De se dire, si on veut politiser les questions d'infrastructures numériques, par exemple, dans un horizon de 5, 10, 15 ans, on pourrait développer des mesures qui rendent visibles, quelque part, les objectifs du déploiement de ces infrastructures. Donc de se dire, si dans 10 ans, on veut développer ou on veut installer massivement, à travers le pays, les infrastructures de télécommunication de type, je ne sais pas, la 8G+, je ne sais pas où on sera rendu là, de se dire, ok, quels sont les impacts, quels sont les objectifs environnementaux, sociaux, économiques visés, quels sont les effets environnementaux et sociaux qu'on peut anticiper, puis de pouvoir rendre, justement, cette logique d'aménagement sous conditionnalité d'un intérêt et d'une compatibilité avec les futures, notamment écologiques, que l'on peut anticiper.
On a un certain nombre de jalons qui touchent à différentes sphères parce que finalement, repositionner ou requestionner même la place du numérique dans nos sociétés, c'est sûr que ça fait appel à toutes les sphères, à travers les usages, à travers la fabrication et à travers la fin de vie de nos équipements, c'est certain.
Tu parlais de la Fing, du Shift Project, enfin, pas mal d'acteurs français. Il n'y en a pas au Québec, il n'y en a pas au Canada ? Est-ce que c'est un sujet au Québec, au Canada, les impacts environnementaux, sociaux, du numérique, ou ce n'est pas du tout un sujet ?
Oui, c'est sûr qu'on a des biais personnels, en tout cas, on a des liens personnels au sens où déjà, beaucoup d'entre nous, dans les personnes qui s'intéressent à ces questions, ont des origines françaises ou en tout cas sont en lien avec des personnes en France. Donc il y a une forme de transmission, je pense, assez facile là-dessus. Et on est quand même dans des territoires francophones. Donc je pense que ce qui se passe en France, même en dehors du numérique, on a tendance à le voir passer davantage que peut-être qu'il se passe plus proche de nous, dans une autre province canadienne, mais qui serait publiée principalement en anglais. Je pense que sur la question de l'intersection entre le numérique et l'environnement, il y a beaucoup de choses qui sont passées du côté francophone et ça a percolé chez nous.
Maintenant, c'est sûr que c'est une question qui gagne en intérêt, qui gagne en intérêt même au Québec et au Canada. C'est encore relativement minoritaire et on n'a pas eu de travaux institutionnels qui ont été faits sur cette question, par exemple, à la même échelle que ce qui a été fait en France. Enfin, en France, ça reste largement imparfait et il y a encore beaucoup à faire. Mais en tout cas, les acteurs plus classiques, publics, ou les grands acteurs économiques, n'ont pas ressenti de pression pour se positionner sur ces enjeux au Québec et au Canada pour le moment. Ou en tout cas, ils sont en discussion de le faire, mais on n'a pas eu ce virage encore.
Cependant, les questions, si on élargit un petit peu aux questions environnementales du numérique, il y a d'autres influences, notamment dans le milieu anglophone, les questions plus décoloniales ou les questions en lien avec les populations autochtones et notamment par le prise numérique. Par exemple, aujourd'hui dans l'IA, la question linguistique des langues autochtones et avec des opinions divergentes sur le potentiel pour interagir davantage avec des langues autochtones grâce à des LLM et d'autres discours plus critiques, par exemple, de volonté d'auto-exclusion en disant, nous, on ne veut pas faire partie de ces processus et de ce que ça implique. On ne veut pas que nos langues soient exploitées de cette manière.
Bref, c'est des questions qu'on peut relier à des préoccupations environnementales ou sociales ou sociétales, qui ne partent pas du prisme français de la propriété numérique, par exemple, tel que ça a été diffusé, mais qui, au final, abordent des questions très similaires, mais à partir d'un autre ancrage culturel.
Dans les usages numériques et dans l'industrie numérique, est-ce qu'il y a des grosses différences entre le Québec et la France ou est-ce que c'est globalement dominé par les GAFAM et l'idéologie véhiculée par la Silicon Valley ?
C'est globalement très similaire. Malheureusement, je pense qu'on a encore plus de frein au changement. Dans ma petite veille régulière sur ces sujets, je commence à avoir quand même des, pour le moment, c'est des signaux faibles, je suis loin de dire que c'est majoritaire, mais on commence à entendre parler d'universités en France ou en Allemagne ou en tout cas en Europe, de l'Ouest principalement, des universités ou des municipalités qui tournent le dos aux GAFAM ou qui vont explorer des solutions libres ou aller davantage vers les communs numériques.
Je pense que je lisais récemment Polytechnique en France ou des villes en Allemagne ou la gendarmerie française qui est passée sous Linux. Pour le moment, je réalise que c'est un peu des cas d'études et c'est des signaux faibles, mais on en manque aujourd'hui beaucoup de ces signaux faibles au Québec, au Canada. Je pense qu'on n'a pas eu le point de bascule où certains joueurs nous montrent que c'est possible. On a un peu un discours encore de l'inéluctabilité ou par exemple avoir ces conversations dans une institution comme celle pour laquelle je travaille, de tourner le dos ou de fermer la porte ou de même songer à quitter dans quelques années les suites, les propriétaires qu'on connaît.
Nous, on est chez Microsoft, donc de pouvoir envisager de quitter Teams dans quelques années, pour le moment, on n'a pas vraiment ce discours. Ce n'est pas un discours qui est vraiment audible. Il est audible, mais en tout cas, il n'est pas opérationnalisable. On nous dit que ce serait ridicule et on nous fait apparaître beaucoup plus de verrou que d'opportunités de changement, que ce soit au niveau de la formation des techniciens, que ce soit au niveau des contrats eux-mêmes sur plusieurs années, que ce soit en matière de normes de sécurité ou de normes légales sur quel type de fournisseurs on peut envisager dans un contexte universitaire. Je pense qu'il nous manque quelques exemples plus proches de notre contexte pour pouvoir engager la discussion.
Malheureusement, on en est encore loin aujourd'hui. En tout cas, on est très à contre-courant quand on aborde ces questions au sein de ces milieux-là.
### Quels sont tes projets actuels ou à venir ?
Eh bien, je continue de travailler sur ces questions. En fait, j'ai encore un pied d'un chemin de transition où je m'assure de la continuité de vue des connaissances qui ont été mobilisées dans le projet. Puis, j'ai commencé un doctorat l'an dernier, en prolongement un petit peu de ces réflexions-là, où je m'intéresse à la place des technologies numériques dans les scénarios de bifurcation économique et écologique.
En gros, j'essaie de croiser un peu les réflexions qui émanent de l'insoutenabilité des trajectoires numériques actuelles et d'un autre côté, toutes les réflexions sur l'insoutenabilité de notre système capitaliste. Je m'intéresse à la place envisagée des technologies numériques dans les scénarios de décroissance, de post-croissance, de planification démocratique de l'économie, ou d'autres scénarios de transition socio-écologique réussis.
On se dit, d'ici 10, 15, 20, 25 ans, à quoi ça ressemble, selon nous, une transition socio-écologique réussie ? Quel type de valeur on envisage derrière ? Quel type de modèle de société on envisage derrière ? Puis, moi, a posteriori, j'essaie de poser la question de quelle place pour les technologies numériques dans cette vision d'une transition socio-écologique réussie ? Donc, c'est ça. J'ai un projet doctoral autour de ça.
Je vais commencer ma thèse certainement l'été prochain. Puis, j'ai des collaborations aussi avec d'autres acteurs sur des thématiques similaires. J'ai une collaboration toute récente avec l'équipe Phenix, qui est située à l'Insa-Lyon, où on a travaillé sur un chapitre de livres ensemble, où on a réalisé des scénarios prospectifs d'un numérique post-croissant. On a réutilisé des méthodes prospectives d'anticipation du futur possible, et on a réalisé quatre scénarios narratifs.
Ils imaginent différentes formes pour un numérique post-croissant à partir de différents leviers. Des leviers géopolitiques, des leviers économiques, des leviers de valeur, on pourrait dire, de projets de société. Ça, c'est un chapitre qui va paraître l'an prochain dans un ouvrage destiné aux imaginaires du développement technologique.
Donc là, justement, tu étais venu en France pour rencontrer un peu tous ces acteurs avec qui tu travailles. Est-ce que tu veux faire passer un message à travers ce podcast ? Est-ce qu'il y a des sujets, des personnes qui seraient intéressées par ces sujets-là qui puissent te contacter ? Est-ce que tu veux nous dire sur quel sujet tu voudrais travailler et qu'on puisse te contacter là-dessus ?
Je suis venu en France assez rapidement, mais pour pouvoir rencontrer certains de ces acteurs avec lesquels je suis en contact. Dans le cas de l'équipe Phenix, ça fait deux ans que je collabore avec eux, mais on ne s'était pas encore rencontrés. On a pu organiser quelques activités scientifiques pour pouvoir réunir d'autres chercheurs, chercheuses qui s'intéressent à ces questions.
Mais oui, absolument. Moi, ça me fait toujours plaisir d'être mis en relation avec des personnes qui pourraient avoir des intérêts connexes. Surtout en recherche, même si pas que.
C'est sûr que c'est des questions sociétales aussi qui ont des dimensions, on pourrait dire, non académiques qui m'intéressent aussi beaucoup. Mais oui, toutes les personnes qui s'intéressent à, on pourrait dire avec des mots-clés un peu sexy, la prospective, le numérique, la post-croissance, des approches plutôt décoloniales du numérique.
Je m'intéresse beaucoup également à cette question un peu de la redirection du numérique, donc avec des inspirations, bien sûr, au niveau de la redirection écologique portée par des personnes comme Alexandre Monin et ses collègues. Je me pose la question, en fait, à la fois des perspectives de numérique alternatif qui soient davantage compatibles avec des logiques de limite planétaire, de décolonisation, de justice sociale.
Et en même temps, je me pose la question des héritages, en fait, actuels du système technologique. Quels usages, quelles infrastructures, quels modes de pensée, quelles valeurs, quelles esthétiques numériques nous sont, enfin, sont aujourd'hui très dominantes et nous sont peut-être évidentes et sont incompatibles, en fait, avec ce qu'on peut anticiper du futur, notamment en matière de contraintes énergétiques, matières ou même de projets sociétés qu'on trouve indésirables.
Donc, de poser un peu cette question de la redirection en prenant en compte à la fois des préoccupations de rupture nécessaire, mais également de continuité. De poser ces questions d'héritage, de perspectives alternatives à faire fleurir.
Je m'intéresse beaucoup aux communs, que ce soit des communs négatifs, les communs plus traditionnels du sens, les communs numériques. Toute personne qui s'intéresse à ces questions et à qui ça parle à travers ces mots-clés, oui, je vous invite bien sûr à me contacter pour trouver mon adresse courriel assez facilement via l'Université de Montréal ou le projet chemin de transition. Ça me fera très plaisir d'être mis en discussion absolument.
Pour finir, est-ce que tu as un conseil lecture ?
En ce moment, c'est sûr que j'ai une veille assez large. Un livre qui a été intéressant de ma perspective parce que ça a remis en question un certain nombre de mes présuppositions, qui s'appelle "From pessimism to promise" et qui a été écrit par Payal Arora, qui s'intéresse aux perspectives surtout du Sud global en matière d'inclusion technologique, donc avec un discours qui est assez critique vis-à-vis de discours que certaines personnes comme moi peuvent avoir en matière de nécessités de dégafaminisation ou de désescalade numérique ou en tout cas de remise en question numérique. C'est un livre qui a été intéressant pour moi, qui apporte d'autres perspectives sur les besoins et sur les volontés de certaines personnes dans les pays du Sud, bien sûr, avec toute la diversité de ces perspectives qui est représentée.
Puis en ce moment, je suis en plein dans la philosophie de la technologie, donc c'est sûr que je repasse à travers Ellul, Illich, Stiegler, Feinberg. Donc c'est des lectures que je trouve quand même intéressantes pour aborder cette question de la place du numérique dans nos sociétés autrement. Le livre de Ellul date de 1954. Je trouve que c'est des écrits qui sont encore quand même très pertinents et finalement assez précurseurs sur la totalité du système technologique, en fait, et de cette gradation qui, malheureusement, continue à outrance.
Andrew Feenberg est un philosophe plus contemporain. Je pense qu'il est en vie encore. Mais il a écrit le livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est un livre de 2010 qui s'appelle "Between Reason and Experience". Il s'attaque un peu à la question de à quel point est-ce qu'on a un contrôle sur les technologies qu'on développe. Et donc lui décrit notamment le développement technologique comme un lieu de lutte permanente entre un design technique et des raisons sociétales, donc des normes, des esthétiques, des attentes. Il essaie de déconstruire les objets technologiques autour de nous pour voir dans quelle perspective est-ce qu'une réappropriation est possible, par exemple une réappropriation des technologies numériques plus démocratiques ou anticapitalistes, bref.
Donc c'est des questions philosophiques et donc peut-être un peu moins immédiatement applicables, mais en tout cas qui informent beaucoup les termes du débat, je trouve, sur ces questions. Ça offre un éclairage sur des discussions qui nous apparaissent parfois nouvelles, mais qui finalement retracent des grands débats de société qu'on a depuis longtemps, depuis plusieurs siècles.